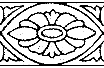16.
Considère ce qu’il faut être pour résister à d’aussi grands orages, et pour écarter habilement les obstacles qui s’opposent au salut de tout un peuple. Il faut tout ensemble être grave et sans faste; se faire craindre et être bon; savoir commander et être affable; incorruptible et obligeant; humble sans bassesse; énergique et doux : c’est avec toutes ces qualités réunies qu’il pourra soutenir la lutte; c’est à ces conditions qu’il acquerra assez d’autorité pour faire passer, malgré une opposition générale, un digne candidat, et comme aussi pour en écarter un indigne, en dépit de la faveur publique, qu’il dédaignera pour n’avoir égard qu’à une seule chose : l’édification de l’Eglise; également inaccessible à la haine et à la faveur.
Eh bien! ai-je eu tort de refuser un honneur si périlleux! Cependant je n’ai pas tout dit, il (591) s’en faut beaucoup. Né te lasse pas d’écouter un ami, un frère qui tient à se justifier des torts dont tu l’accuses. Outre l’avantage de me disculper dans ton esprit, j’aurai encore celui de t’être dé quelque utilité pour ton administration. Quand on est sur le point d’entrer dans cette carrière, il est nécesSaire de sonder avant tout le terrain; c’est une précaution qu’il faut prendre avant de s’y engager pour tout de bon. Pourquoi cela? Parce qu’ainsi on gagnera du moins de n’être pas pris au dépourvu; viennent après cela les difficultés, elles trouveront un homme prêt à les bien combattre parce qu’il les connaît.
Te parlerai-je de la direction des veuves, de la sollicitude dont il faut entourer les vierges, des difficultés que présente la juridiction ecclésiastique? Les soins que réclamé chacune de ces branches de l’administration ecclésiastique sont grands, et les dangers que l’évêque y rencontre, plus grands encore.
Commençons par ce qui paraît le plus facile, le soin des veuves. Il semble d’abord que ce soit une chose fort simple, et que celui qui s’en occupe a tout fait quand il a dépensé une certaine somme d’argent en distributions de secours. (Tim. V, 16.) Il n’en est rien cependant une grande circonspection est encore ici nécessaire, surtout quand il s’agit de les inscrire an rôle de l’Eglise; les inscrire au hasard, et comme cela se trouve, produit les maux les plus graves. On a vu des veuves ruiner des maisons, troubler des ménages, se déshonorer par le vol, par la fréquentation des cabarets et par d’autres honteux désordres. Nourrir de telles femmes avec les revenus de l’Eglise , c’est attirer sur soi la vengeance de Dieu et le blâme sévère des hommes, c’est refroidir la charité des bienfaiteurs. Qui pourrait souffrir que les charités qu’on lui demande et qu’il fait au nom de Jésus-Christ, passent aux mains de ceux qui déshonorent lé nom dé Jésus-Christ? Voilà des raisons qui rendent un sévère examen nécessaire ; il l’est encore pour empêcher que d’autres veuves, qui peuvent suffire à leurs besoins, ne se joignent à celles dont je viens de parler pour ravager la table des pauvres.
Ces précautions prises , un autre souri se présente, souci grave : il faut prendre des mesures pour que les choses nécessaires à leur entretien ne manquent point, mais coulent comme une source qui ne tarit jamais. Le malheur de la pauvreté involontaire, c’est d’être insatiable: elle se plaint sans cesse, elle est ingrate. On a besoin de beaucoup de prudence, de beaucoup de zèle, pour lui fermer la bouche, en lui ôtant tout prétexte de plainte. Cependant, qu’un homme se montre supérieur à l’amour de l’argent, et la foule, aussitôt, le proclame capable de remplir cette charge; pour moi; je reconnais que le désintéressement est une qualité indispensable, sans laquelle on serait un dévastateur et non pas un administrateur, un loup plutôt qu’un berger; mais je ne pense pas qu’elle suffise toute seule: avec elle il y a une autre vertu que je veux trouver dans un candidat.
Cette vertu est, pour les hommes, la source des plus grands biens ; elle conduit l’âme comme dans un port tranquille et à l’abri des orages : c’est la patience. Or , la classe des veuves, forte de sa pauvreté, de son âge, de son sexe, use volontiers d’une liberté de langue assez peu limitée, pour ne rien dire dé plus. Elles crient à contre-temps, elles accusent à tort et à travers, elles se plaignent quand elles devraient exprimer leur reconnaissance, elles blâment quand il conviendrait d’approuver. Il faut que l’évêque ait le courage de tout supporter : leurs clameurs importunes, ni leurs plaintes indiscrètes, rien ne doit exciter sa colère. Leurs misères sont plus dignes de compassion que de reproche : insulter à leurs infortunes, ajouter aux amertumes de la pauvreté, celles de l’affront serait de la dernière barbarie. C’est pourquoi le Sage, considérant d’un côté l’avariée et l’orgueil naturels à l’homme, sachant d’un autre côté combien la pauvreté est capable d’abattre l’âme la plus noble, et de conseiller une importunité effrontée, ne veut pas que celui qui est en butte à ces ennuyeuses sollicitations, s’en mette en colère. En s’irritant contre les pauvres à cause de l’assiduité de leurs demandes, il s’exposerait à devenir leur ennemi, au lieu d’être leur consolateur comme il le doit. Le Sage lui recommande donc de se montrer affable et d’un abord facile. Incline sans humeur ton oreille vers le pauvre, réponds-lui avec douceur des paroles de paix. (Eccli. IV, 8.)
Le même Sage, sans dire un mot de réprimande à l’importun (qui aurait ce courage vis-à-vis d’un suppliant prosterné?) continue de s’adresser à celui qui est en état de secourir l’indigence, et il l’exhorte à relever le pauvre par un doux regard, par une bonne parole, avant de le faire par l’aumône. (592)
Or, si quelqu’un, sans voler le bien des veuves, s’emporte jusqu’à les maltraiter de paroles ou autrement, non-seulement il n’allége point le fardeau de leur pauvreté, mais il l’aggrave. L’effronterie où les porte le besoin qui les presse, ne les empêche pas de ressentir l’injure. La crainte de la faim les force à mendier, la mendicité produit l’effronterie, et l’effronterie à son tour attire les humiliations, cercle fatal qui tient l’âme enfermée dans les ténèbres et dans le désespoir.
Il faut donc qu’un administrateur ait assez de patience pour ne pas accroître leur douleur par ses violences, pour calmer en grande partie leur affliction par des paroles de consolatiou. Le pauvre que l’on insulte est peu touché de l’aumône qu’on lui donne, si abondante qu’elle soit; le secours en argent ne compense pas la blessure faite à l’amour-propre. Au contraire celui qui entend une bonne parole, qui reçoit une consolation en même temps qu’une aumône, éprouve une joie, une satisfaction bien plus grande. La manière de donner a doublé le don. Ce que je dis là n’est pas de moi, mais de celui qui nous exhortait tout à l’heure:
Mon fils, dit-il, ne mêle point les reproches au bien que tu fais, n’accompagne point les dons de paroles affligeantes: La rosée ne rafraîchit-elle point la trop grande chaleur? une douce parole vaut mieux que le don. Oui, une seule parole est meilleure que l’offrande; et tous les deux se trouvent dans l’homme charitable. (Eccli. XVIII, 15, 17.)
Mais si celui qui prend la charge des veuves doit avoir de la douceur et de la patience, il faut de plus qu’il entende l’économie. Si cette qualité lui manque, le bien des pauvres n’en souffrira pas moins. J’ai ouï parler d’un homme, qui, chargé de cette partie de l’administration, ne dispensa aux pauvres qu’une petite portion de l’argent assez considérable destiné aux aumônes. Il est vrai qu’il ne dépensa point le reste pour son propre usage, mais il le cacha soigneusement sous terre, où il le conservait. Une guerre survint, l’argent fut découvert et pris par l’ennemi, Il y a donc ici un juste milieu à garder, c’est que l’Eglise ne soit ni riche ni pauvre. A mesure que tu reçois, distribue aux indigents. Si l’Eglise a des trésors, qu’ils résident dans les coeurs des fidèles.
Au chapitre des veuves, ajoutons l’hospitalité qu’il faut offrir aux étrangers, et les secours que l’on doit aux malades; quelle dépense croistu qu’exigent ces détails, et quelle activité, quelle prudence sont nécessaires pour s’en bien acquitter? La dépense n’est pas moindre que celle dont nous venons de parler, souvent même elle est plus considérable. Quant au dispensateur, il faut qu’il ait le talent de se procurer des ressources; mais la discrétion et la prudence lui sont nécessaires pour engager les personnes en état de donner, à donner généreusement et volontiers; il doit pourvoir au soulagement des malades sans blesser l’esprit des bienfaiteurs. Le soin des malades exige toute l’activité, toute la diligence possible; ils sont pour l’ordinaire fâcheux et sans énergie, et, à moins de précautions et de sollicitudes infinies, la plus légère négligence peut leur être extrêmement préjudiciable.