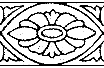CHAPITRE IV.
CE QUE PENSENT LES CHRÉTIENS SUR LE SOUVERAIN BIEN, CONTRE LES PHILOSOPHES QUI ONT CRU LE TROUVER EN EUX-MÊMES.
Si l’on nous demande quel est le sentiment de la Cité de Dieu sur tous ces points, et d’abord touchant la fin des biens et des maux, elle-même répondra que la vie éternelle est le souverain bien et la mort éternelle le souverain mal, et qu’ainsi nous devons tâcher de bien vivre, afin d’acquérir l’une et d’éviter l’autre. Il est écrit « Le juste vit de la foi1 » En effet, en cette vie, nous ne voyons point encore notre bien, de sorte que nous le devons chercher par la foi, n’ayant pas en nous-mêmes le pouvoir de bien vivre, si celui qui nous a donné la foi dans son assistance ne nous aide à croire et à prier. Pour ceux qui ont cru que le souverain bien est en cette vie, qu’ils l’aient placé dans le corps ou dans l’âme, ou dans tous les deux ensemble, ou, pour résumer tous les systèmes, qu’ils l’aient fait consister dans la volupté, ou dans la vertu, ou dans l’une et l’autre; dans le repos, ou dans la vertu, ou dans l’un et l’autre; dans la volupté et le repos, ou dans la vertu, ou dans tout cela pris ensemble; enfin dans les premiers biens de la nature, ou dans la vertu, ou dans ces objets réunis, c’est en tous cas une étrange vanité d’avoir placé leur béatitude ici-bas, et surtout de l’avoir fait dépendre d’eux-mêmes. La Vérité se rit de cet orgueil, quand elle dit par un prophète : «Le Seigneur sait que les pensées des hommes sont vaines, ou comme parle l’apôtre saint Paul : « Le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu’elles sont vaines 2 ».
Quel fleuve d’éloquence suffirait à dérouler toutes les misères de cette vie? Cicéron l’a essayé comme il a pu dans la Consolation sur la mort de sa fille 3; mais que ce qu’il a pu est peu de chose! En effet, ces premiers biens de la nature, les peut-on posséder en cette vie qu’ils ne soient sujets à une infinité de révolutions? Y a-t-il quelque douleur et quelque inquiétude (deux affections diamétralement opposées à la volupté et au repos) auxquelles le corps du sage ne soit exposé? Le retranchement ou la débilité des membres est contraire à l’intégrité des parties du corps, la laideur à sa beauté, la maladie à sa santé, la lassitude à ses forces, la langueur ou la pesanteur à son agilité; et cependant, quel est celui de ces maux dont le sage soit exempt? L’équilibre du corps et ses mouvements, quand ils sont dans la juste mesure, comptent aussi parmi les premiers biens de la nature. Mais que sera-ce, si quelque indisposition fait trembler les membres? que sera-ce, si l’épine du dos se courbe, de sorte qu’un homme soit obligé de marcher à quatre pattes comme une bête? Cela ne détruira-t-il pas l’assiette ferme et droite du corps, la beauté et la mesure de ses mouvements? Que dirai-je des premiers biens naturels de l’âme, le sens et l’entendement, dont l’un lui est donné pour apercevoir la vérité, et l’autre pour la comprendre ? Où en sera le premier, si un homme devient sourd et aveugle ; et le second, s’il devient fou? Combien les frénétiques font-ils d’extravagances qui nous tirent les larmes des yeux, quand nous les considérons sérieusement? Parlerai-je de ceux qui sont possédés du démon? Où leur raison est-elle ensevelie, quand le malin esprit abuse de leur âme et de leur corps à son gré? Et qui peut s’assurer que cet accident n’arrivera point au sage pendant sa vie ? Il y a plus: combien défectueuse est la connaissance de la vérité ici-bas, où, selon les paroles de la Sagesse, « ce corps mortel et corruptible appesantit l’âme, et cette demeure de terre et de boue émousse l’esprit qui pense beaucoup4 ». Cette activité instinctive (que les Grecs appellent orme) également comptée au nombre des premiers biens de la nature5, n’est-elle pas dans les furieux la cause de ces mouvements et de ces actions qui nous font horreur?
Enfin, la vertu, qui n’est pas au nombre des biens de la nature, puisqu’elle est un fruit tardif de la science, mais qui toutefois réclame le premier rang parmi les biens de l’homme, que fait-elle sur terre, sinon une guerre continuelle contre les vices, je ne parle pas des vices qui sont hors de nous, mais de ceux qui sont en nous, lesquels ne nous sont pas étrangers, mais nous appartiennent en propre? Quelle guerre doit surtout soutenir cette vertu que les Grecs nomment sophrosune, et nous tempérance , quand il faut réprimer les appétits désordonnés de la chair, de peur qu’ils ne fassent consentir l’esprit à des actions criminelles? Et ne nous imaginons pas qu’il n’y ait point de vice en nous, lorsque « la chair, comme dit l’Apôtre, convoite contre l’esprit » 6 ; puisqu’il existe une vertu directement contraire, celle que désigne ainsi le même Apôtre : « L’esprit convoite contre la chair » ; et il ajoute : « Ces principes sont contraires l’un à l’autre, et vous ne faites pas ce que vous voudriez7 ». Or, que voulons-nous faire, quand nous voulons que le souverain bien s’accomplisse en nous, sinon que la chair s’accorde avec l’esprit et qu’il n’y ait plus entre eux de divorce? Mais , puisque nous ne le saurions faire en cette vie, quelque désir que nous en ayons, tâchons au moins, avec le secours de Dieu, de ne point consentir aux convoitises déréglées de la chair. Dieu nous garde donc de croire, déchirés que nous sommes par cette guerre intestine, que nous possédions déjà la béatitude qui doit être le fruit de notre victoire t Et qui donc est parvenu à ce comble de sagesse qu’il n’ait plus à lutter contre ses passions?
Que dirai-je de cette vertu qu’on appelle prudence? Toute sa vigilance n’est-elle pas occupée à discerner le bien d’avec le mal, pour rechercher l’un et fuir l’autre ? Or, cela ne prouve-t-il pas que nous sommes dans le mal et que le mal est en nous? Nous apprenons par elle que c’est un mal de consentir à nos mauvaises inclinations, et que c’est un bien d’y résister; et cependant ce mal, à qui la prudence nous apprend à ne pas consentir et que la tempérance nous fait combattre, ni la tempérance, ni la prudence ne le font disparaître. Et la justice, dont l’emploi est de rendre à chacun ce qui lui est dû8 (par où se maintient en l’homme cet ordre équitable de la nature, que l’âme soit soumise à Dieu, le corps à l’âme, et ainsi l’âme et le corps à Dieu), ne fait-elle pas bien voir, par la peine qu’elle prend à s’acquitter de cette fonction, qu’elle n’est pas encore à la fin de son travail ? L’âme est en effet d’autant moins soumise à Dieu qu’elle pense moins à lui; et la chair est d’autant moins soumise à l’esprit qu’elle a plus de désirs qui lui sont contraires. Ainsi, tant que nous sommes sujets à ces faiblesses et à ces langueurs, comment osons-nous dire que nous sommes déjà sauvés? Et si nous ne sommes pas encore sauvés, de quel front pouvons-nous prétendre que nous sommes bienheureux? Quant à la force, quelque sagesse qui l’accompagne, n’est-elle pas un témoin irréprochable des maux qui accablent les hommes et que la patience est contrainte de supporter ? En vérité, je m’étonne que les Stoïciens aient la hardiesse de nier que ce soient des maux, en même temps qu’ils prescrivent au sage, si ces maux arrivent à un point qu’il ne puisse ou ne doive pas leS souffrir, de se donner la mort, de sortir de la vie9. Cependant telle est la stupidité où l’orgueil fait tomber ces philosophes, qui veulent trouver en cette vie et en eux-mêmes le principe de leur félicité, qu’ils n’ont point de honte de dire que leur sage, celui dont ils tracent le fantastique idéal , est toujours heureux, devînt-il aveugle, sourd, muet, impotent, affligé des plus cruelles douleurs et de celles-là mêmes qui l’obligent à se donner la mort. O la vie heureuse, qui, pour cesser d’être, cherche le secours de la mort! Si elle est heureuse, que n’y demeure-t-on; et si on la fuit à cause des maux qui l’affligent comment est-elle bienheureuse? Se peut-il faire qu’on n’appelle point mal ce qui triomphe du courage même, ce qui ne l’oblige pas seulement à se rendre, mais le porte encore à ce délire de regarder comme heureuse une vie que l’on doit fuir? Qui est assez aveugle pour ne pas voir que si on doit la fuir, c’est qu’elle n’est pas heureuse? et s’ils avouent qu’on la doit fuir à cause des faiblesses qui l’accablent, que ne quittent-ils leur superbe, pour avouer aussi qu’elle est misérable ? N’est-ce pas plutôt par impatience que par courage que ce fameux Caton s’est donné la mort, et pour n’avoir pu souffrir César victorieux? Où est la force de cet homme tant vanté? Elle a cédé, elle a succombé, elle a été tellement surmontée qu’il a fui et abandonné une vie bienheureuse. Elle ne l’était plus , dites-vous? Avouez donc qu’elle était malheureuse. Et dès lors, comment ce qui rend une vie malheureuse et détestable ne serait-il pas un mal?
Aussi les Péripatéticiens et ces philosophes de la vieille Académie, dont Varron se porte le défenseur, ont-ils eu la sagacité de céder sur ce point; mais leur erreur est encore étrange de soutenir que malgré tous les maux, le sage ne laisse pas d’être heureux. « Les tortures et les douleurs du corps sont des maux, dit Varron, et elles le sont d’autant plus qu’elles prennent plus d’accroissement ; et voilà pourquoi il faut s’en délivrer en sortant de la vie ». De quelle vie, je vous prie? De celle, dit Varron, qui est accablée de tant de maux. Quoi donc! est-ce de cette vie toujours heureuse au milieu même des maux qui doivent nous en faire sortir? ou ne l’appelez- vous heureuse que parce qu’il vous est permis de vous en délivrer? Que serait-ce donc si quelque secret jugement de Dieu vous retenait parmi ces maux sans permettre à la mort de vous en affranchir jamais! Alors du moins seriez-vous obligés d’avouer qu’une vie de cette sorte est misérable. Ce n’est donc pas pour être promptement quittée qu’elle n’est pas misérable, à moins de vouloir appeler félicité une courte misère. Certes, il faut que des maux soient bien violents pour obliger un homme, et un homme sage, à cesser d’être homme pour s’en délivrer. Ils disent, en effet, et avec raison, que c’est le premier cri de la nature que l’homme s’aime soi-même, et partant qu’il ait une aversion instinctive pour la mort et cherche tout ce qui peut entretenir l’union du corps et de l’âme10. Il faut donc que des maux soient bien violents pour étouffer ce sentiment de la nature et l’éteindre à ce point que nous désirions la mort et tournions nos propres mains contre nous-mêmes, si personne ne consent à nous la donner. Encore une fois, il faut que des maux soient bien violents pour rendre la force homicide, si néanmoins la force mérite encore son nom, alors qu’elle succombe sous le mal et non-seulement ne peut conserver par la patience un homme dont elle avait pris le gouvernement et la protection, mais se voit réduite à le tuer. Oui, j’en conviens, le sage doit souffrir la mort avec patience , mais quand elle lui vient d’une main étrangère; si donc, suivant eux, il est obligé de se la donner, il faut qu’ils avouent que les accidents qui l’y obligent ne sont pas seulement des maux, mais des maux insupportables. A coup sûr, une vie sujette à tant de misères n’eût jamais été appelée heureuse, si ceux qui lui donnent ce nom cédaient à la vérité comme ils cèdent à la douleur, au lieu de prétendre jouir du souverain bien dans un lieu où les vertus même, qui sont ce que l’homme a de meilleur ici-bas, sont des témoins d’autant plus fidèles de nos misères qu’elles travaillent davantage à nous en garantir. Si ce sont donc des vertus véritables, et il ne peut y en avoir de telles qu’en ceux qui ont une véritable piété, elles ne promettent à personne de le délivrer de toutes sortes de maux; non, elles ne font pas cette promesse, parce qu’elles ne savent pas mentir; tout ce qu’elles peuvent faire, c’est de nous assurer que si nous espérons dans le siècle à venir, cette vie humaine, nécessairement misérable à cause des innombrables épreuves du présent, deviendra un jour bienheureuse en gagnant du même coup le salut et la félicité. Mais comment posséderait-elle la félicité, quand elle ne possède pas encore le salut? Aussi l’apôtre saint Paul, parlant, non de ces philosophes véritablement dépourvus de sagesse, de patience, de tempérance et de justice, mais de ceux qui ont une véritable piété et par conséquent des vertus véritables, dit : « Nous sommes sauvés en espérance. Or, la vue de l’objet espéré n’est plus de l’espérance. Car qui espère ce qu’il voit déjà? Si donc nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, c’est que nous l’attendons par la patience11 ». Il en est de notre bonheur comme de notre salut; nous ne le possédons qu’en espérance ; il n’est pas dans le présent, mais dans l’avenir, parce que nous sommes au milieu de maux qu’il faut supporter patiemment, jusqu’à ce que nous arrivions à la jouissance de ces biens ineffables qui ne seront traversés d’aucun déplaisir. Le salut de l’autre vie sera donc la béatitude finale, celle que nos philosophes refusent de croire, parce qu’ils ne la voient pas, substituant à sa place le fantôme d’une félicité terrestre fondée sur une trompeuse vertu, d’autant plus superbe qu’elle est plus fausse.
-
Habacuc, II, 4; Galat. III, 11. ↩
-
I Cor. III, 20. ↩
-
Cet ouvrage est perdu, sauf un petit nombre de courts fragments que Lactance noua a conservés. Le morceau qui se trouve dans les oeuvres de Cicéron sous le nom de Consolation est un pastiche industrieux de quelque cicéronien de la renaissance. ↩
-
Sag. IX, 15. ↩
-
Voyez Cicéron, De finibus, lib. V, cap, 6; De nat. Deor., lib. II, cap. 22. ↩
-
« Les Grecs, dit Cicéron, appellent sophrosune cette vertu que j’ai coutume de nommer tempérance ou modération, quelquefois aussi mesure (Tusculanes, livre III, ch. 8) ». Comparez Platon, République, livre IV. ↩
-
Galat. V, 17. ↩
-
C’est la définition consacrée par le droit romain : La justice est une volonté perpétuelle et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû (Instit., tit. de Justitia et jure) ». ↩
-
L’école stoïcienne permettait et même en certains cas commandait le suicide. Caton, Brutus et bien d’autres ont pratiqué jusqu’en bout ce qu’ils croyaient leur droit ou leur devoir. ↩
-
Ce sont presque les expressions de Cicéron dans le De finibus, lib. V, cap 5. Comp. Ibid., lib. V, cap. 9, et le De officies, lib. I, cap,4. ↩
-
Rom. VIII, 24, 25. ↩