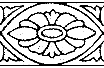CHAPITRE PREMIER.
IL PEUT Y AVOIR, SELON VARRON, DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT SYSTÈMES PHILOSOPHIQUES TOUCHANT LE SOUVERAIN BIEN.
Puisqu’il me reste à traiter de la fin de chacune des deux cités, je dois d’abord rapporter en peu de mots les raisonnements où s’égarent les hommes pour aboutir à se faire une béatitude parmi les misères de cette vie ; je dois en même temps faire voir, non-seulement par l’autorité divine, mais encore par la raison, combien il y a de différence entre les chimères des philosophes et l’espérance que Dieu nous donne ici-bas et qui doit être suivie de la véritable félicité. Les philosophes ont agité fort diversement la question de la fin des biens et des maux1, et se sont donné beaucoup de peine pour trouver ce qui peut rendre l’homme heureux. Car la fin suprême, quant à notre bien, c’est l’objet pour lequel on doit rechercher tout le reste et qui ne doit être recherché que pour lui-même; et quant à notre mal, c’est aussi l’objet pour lequel il faut éviter tout le reste et qui ne doit être évité que pour lui-même. Ainsi, par la fin du bien, nous n’entendons pas une fin où il s’épuise jusqu’à n’être plus, mais où il s’achève pour atteindre à sa plénitude, et pareillement par la fin du mal , nous ne voulons pas parler de ce qui détruit le mal , mais de ce qui le porte à son comble. Ces deux fins sont donc le souverain bien et le souverain mal, et c’est pour les trouver que se sont beaucoup tourmentés, comme je le disais, ceux qui, parmi les vanités du siècle, ont fait profession d’aimer la sagesse. Mais, quoiqu’ils aient erré en plus d’une façon, la lumière naturelle ne leur a pas permis de s’éloigner tellement de la vérité qu’ils n’aient mis le souverain bien et le souverain mal, les uns dans l’âme, les autres dans le corps, et les autres dans tous les deux. De cette triple division, Varron, dans son livre De la Philosophie2, tire une si grande diversité de sentiments, qu’en y ajoutant quelques légères différences , il compte jusqu’à deux cent quatre-vingt-huit sectes, sinon réelles, du moins possibles.
Voici comment il procède : « Il y a, dit-il, quatre choses que les hommes recherchent naturellement, sans avoir besoin de maître ni d’art, et qui sont par conséquent antérieures à la vertu (laquelle est très-certainement un fruit de la science3): premièrement, la volupté, qui est un mouvement agréable des sens; en second lieu, le repos, qui exclut tout ce qui pourrait incommoder le corps; en troisième lieu, ces deux choses réunies, qu’Epicure a même confondues sous le nom de volupté4; enfin, les premiers biens de la nature, qui comprennent tout ce que nous venons de dire et d’autres choses encore, comme la santé et l’intégrité des organes, voilà pour le corps, et les dons variés de l’esprit, voilà pour l’âme. Or, ces quatre choses, volupté, repos, repos et volupté, premiers biens de la nature, sont en nous de telle sorte qu’il faut de trois choses l’une: ou rechercher la vertu pour elles, ou les rechercher pour la vertu, ou ne les rechercher que pour elles-mêmes; et de là naissent douze sectes. A ce compte, en effet, chacune est triplée, comme je vais le faire voir pour une d’elles, après quoi il ne sera pas difficile de s’en assurer pour les autres. Que la volupté du corps soit soumise, préférée ou associée à la vertu, cela fait trois sectes. Or, elle est soumise à la vertu, quand on la prend pour instrument de la vertu. Ainsi, il est du devoir de la vertu de vivre pour la patrie et de lui engendrer des enfants, deux choses quine peuvent se faire sans volupté. Mais quand on préfère la volupté à la vertu, on ne recherche plus la volupté que pour elle-même; et alors la vertu n’est plus qu’un moyen pour acquérir ou pour conserver la volupté, et cette vertu esclave ne mérite plus son nom. Ce système infâme a pourtant trouvé des défenseurs et des apologistes parmi les philosophes. Enfin, la volupté est associée à la vertu, quand on ne les recherche point l’une pour l’autre, mais chacune pour elle-même. Maintenant, de même que la volupté, tour à tour soumise, préférée ou associée à la vertu, a fait trois sectes, de même le repos, la volupté avec le repos, et les premiers biens de la nature, en font aussi un égal nombre, sui vaut qu’elles sont soumises, préférées ou associées à la vertu, et ainsi voilà douze sectes. Mais ce nombre devient double en y ajoutant une différence, qui est la vie sociale. En effet, quiconque embrasse quelqu’une de ces sectes, ou le fait seulement pour soi, ou le fait aussi pour un autre qu’il s’associe et à qui il doit souhaiter le même avantage. Il y aura donc douze sectes de philosophes qui ne professeront leur doctrine que pour eux-mêmes, et douze qui l’étendront à leurs semblables, dont le bien ne les touchera pas e moins que leur bien propre. Or, ces vingt-quatre sectes se doublent encore et montent jusqu’à quarante-huit, en y ajoutant une différence prise des opinions de la nouvelle Académie5. De ces vingt-quatre opinions, en effet, chacune peut être soutenue comme certaine, et c’est ainsi que les Stoïciens ont prétendu qu’il est certain que le souverain bien de l’homme ne consiste que dans la vertu, ou comme incertaine et seulement vraisemblable, comme ont fait les nouveaux académiciens. Voilà donc vingt-quatre sectes de philosophes qui défendent leur opinion comme assurée, et vingt-quatre autres qui la soutiennent comme douteuse. Bien plus, comme chacune de ces quarante-huit sectes peut être embrassée, ou en suivant la manière de vivre des autres philosophes, ou en suivant celle des cyniques, cette différence les double encore et en fait quatre-vingt-seize. Ajoutez enfin à cela que, comme on peut embrasser chacune d’elles, ou en menant une vie tranquille, à l’exemple de ceux qui, par goût ou par nécessité, ont donné tous leurs moments à l’étude, ou bien une vie active, à la manière de ceux qui ont joint l’étude de la philosophie au gouvernement de l’Etat, ou une vie mêlée des deux autres, tels que ceux qui ont donné une partie de leur loisir à la contemplation et l’autre à l’action, ces différences peuvent tripler le nombre des sectes et en faire jusqu’à deux cent quatre-vingt-huit ».
Voilà ce que j’ai recueilli du livre de Varron le plus succinctement et le plus clairement qu’il m’a été possible, en m’attachant à sa pensée sans citer ses expressions. Or , de dire maintenant comment cet auteur, après avoir réfuté les autres sectes, en choisit une qu’il prétend être celle des anciens académiciens, et comment il distingue cette école, suivant lui dogmatique, dont Platon est le chef et Polémon le quatrième et dernier représentant, d’avec celle des nouveaux académiciens qui révoquent tout en doute, et qui commencent à Arcésilas, successeur de Polémon6 ; de rapporter, dis-je, tout cela en détail, aussi bien que les preuves qu’il allègue pour montrer que les anciens académiciens ont été exempts d’erreur comme de doute, c’est ce qui serait infiniment long, et cependant il est nécessaire d’en dire un mot. Varron rejette donc dès l’abord toutes les différences qui ont si fort multiplié ces sectes , et il les rejette parce qu’elles ne se rapportent pas au souverain bien. Suivant lui, en effet, une secte philosophique n’existe et ne se distingue des autres, qu’à condition d’avoir une opinion propre sur le souverain bien. Car l’homme n’a d’autre objet en philosophant que d’être heureux; or, ce qui rend heureux, c’est le souverain bien , et par conséquent toute secte qui n’a pas pour aller au souverain bien sa propre voie n’est pas vraiment une secte philosophique. Ainsi, quand on demande si le sage doit mener une vie civile et sociale et procurer à son ami tout le bien qu’il se procure à lui-même, ou s’il ne doit rechercher la béatitude que pour soi, il est question, non pas du souverain bien, mais de savoir s’il y faut associer quelque autre avec soi. De même, quand on demande s’il faut révoquer toutes choses en doute comme les nouveaux académiciens, ou si l’on doit les tenir pour certaines avec les autres philosophes, on ne demande pas quel est le bien qu’on doit rechercher, mais s’il faut douter ou non de la vérité du bien que l’on recherche. La manière de vivre des cyniques, différente de celle des autres philosophes, ne concerne pas non plus la question du souverain bien; mais, la supposant résolue, on demande seulement s’il faut vivre comme les cyniques. Or, il s’est trouvé des hommes qui, tout en plaçant le souverain bien en différents objets, les uns dans la vertu et les autres dans la volupté, n’ont pas laissé de mener le genre de vie qui a valu aux cyniques leur nom7. Ainsi, ce qui fait la différence entre les cyniques et les autres philosophes est étranger à la question de la nature du souverain bien. Autrement, la même manière de vivre impliquerait la même fin poursuivie, et réciproquement, ce qui n’a pas lieu.
-
Ici, comme dans tout le cours du livre XIX, il est clair que saint Augustin se souvient du traité bien connu de Cicéron qui porte pour titre : De finibus bonorum et malorum, c’est-à-dire De la lin dernière où tendent les biens et les maux. ↩
-
Ouvrage perdu. ↩
-
Sur la question, tant controversée par les anciens, si la verts peut, ou non, être enseignée, voyez Platon (dans le Protagoras et le Ménon) et Plutarque en son traité : Que la vertu est chose qui s’enseigne. ↩
-
Le mot d’Epicure est edone. ↩
-
Sur la nouvelle Académie, voyez ci-après. ↩
-
L’école académique, qui tire son nom d’un gymnase situé aux jardins d’Académus, près duquel habitait Platon, embrasse une période de quatre siècles, depuis Platon jusqu’à Antiochus. Les uns admettent trois académies : l’ancienne, celle de Platon, la moyenne, celle d’Arcésilas, la nouvelle, celle de Carnéade. Les autres en admettent quatre, savoir, avec les trois précédentes, celle de Philon. D’autres enfin ajoutent une cinquième académie, celle d’Antiochus, maître de Varron, de Lucullus et de Cicéron. — Parmi ces distinctions, une seule est importante, celle qui sépare Platon et ses vrais disciples, Speusippe et Xénocrate, de cette famille de faux platoniciens, de demi-sceptiques dont Arcésilas est le père et A.ntiochus le dernier membre considérable. ↩
-
Allusion à certains Epicuriens et même à certains Stoïciens qui se rapprochaient beaucoup des cyniques dans leur manière de vivre. ↩