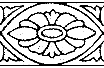7.
Quand il se fut un peu remis du trouble qui agitait son âme:
Si mon intérêt, dit-il, est pour toi si peu de chose; si, pour un motif que j’ignore, tu ne tiens de moi nul compte, au moins devrais-tu songer à ta propre réputation. Tu as mis en mouvement toutes les langues : on dit que c’est l’amour de la vaine gloire qui t’a fait refuser cette dignité sainte, et personne n’essaie de te justifier. Pour moi, je n’ose plus me montrer en public, tant il y a de gens qui m’abordent chaque fois pour m’adresser leurs reproches. Dès que je parais quelque part dans la ville, il n’en est pas un de ceux qui sont liés avec nous, qui ne me prenne à part, et ne rejette sur moi la plus grande partie de la faute. Puisque tu (567) connaisais ses intentions, me disent-ils, car il n’avait rien de caché pour toi, il ne fallait pas les tenir secrètes, mais nous les communiquer, et nous n’aurions pas été embarrassés pour trouver un moyen de le prendre dans nos filets. Et moi, j’ai honte, je rougis de dire devant eux que j’ignorais complètement ce que tu méditais depuis longtemps déjà : ils pourraient croire que notre amitié n’était qu’une comédie. Elle a beau n’être que cela, (comme elle n’est que cela en effet, et tu ne saurais dire le contraire après la conduite que tu as tenue envers moi), il est cependant convenable de cacher nos misères aux étrangers, surtout quand ils ont de nous une assez bonne opinion. Je n’ose donc dire devant eux ce qu’il en est, et comment nous sommes entre nous. Ainsi je suis obligé de me taire, de baisser les yeux, d’éviter ceux que je vois venir, de m’esquiver. Mais ce premier reproche évité m’en attire nécessairement un autre, celui de dissimulation. Car, on ne voudra jamais s’arrêter à l’idée que tu as mis Basile au nombre de ceux qu’il ne convenait pas de prendre pour confidents de tes pensées.
Mais cela te fait trop plaisir, pour que je m’en afflige beaucoup. Ce n’est pas tout, il me reste beaucoup de choses à dire dont je ne sais comment nous supporterons la honte. Tout le monde t’accuse, ceux-ci d’arrogance, ceux-là de vanité. Les moins modérés vont jusqu’à nous faire à tous les deux ce double reproche : ils ne ménagent pas l’injure même à ceux qui nous ont appelés à cet honneur. Les électeurs ont bien mérité, disent-ils, ce qui leur est arrivé; eussent-ils même essuyé un plus grave affront, il ne faudrait pas les plaindre : eux qui, laissant de côté tant d’hommes mûrs et de mérite, sont allés prendre des enfants, hier et avant-hier encore plongés dans les vanités du siècle, pour les élever tout à coup à une dignité telle qu’ils ne s’y seraient pas attendus même en songe, et cela parce qu’on les a vus un moment froncer le sourcil, s’envelopper de manteaux noirs, prendre des airs de modestie affectée. Ainsi des vieillards, dont la vie tout entière s’est consumée dans les exercices de la vie religieuse, sont gouvernés, et qui est-ce qui gouverne? leurs enfants, qui n’ont pas même entendu parler des règles qu’il faut suivre dans le gouvernement.
Tels et plus graves encore sont les reproches dont nous sommes assaillis sans relâche. A cela que répondre? pour ma part je ne le sais pas, et je te prie de me le dire. Car enfin cette fuite, tu ne t’y es pas résolu sans réflexion et en étourdi.; avant de te risquer à offenser gravement de si hauts personnages, tu as dû réfléchir et délibérer; je suppose donc que tu n’es pas embarrassé de te justifier. Parle, je t’en prie, situ as quelque bonne excuse capable de fermer la bouche à tes accusateurs. Pour les torts que tu as eus envers moi, je t’en tiens quitte, je ne me plains pas d’avoir été trompé, trahi, exploité par toi. Moi, j’avais pour ainsi dire déposé mon âme dans tes mains; et toi, tu as usé de ruse comme s’il s’était agi de te prémunir contre un ennemi. Si le sacerdoce te paraissait une bonne chose, tu devais en accepter les avantages; si au contraire tu le jugeais nuisible, il fallait me préserver du préjudice, moi qui tenais, disais-tu, la première place dans ton coeur. Mais au contraire tu as tout fait pour que je tombasse dans le piége. Il t’a sans doute fallu beaucoup de ruse et de dissimulation vis-à-vis d’un homme qui fut toujours simple, sans détour pour toi dans ses paroles comme dans ses actions.
Mais encore une fois, je ne te fais pas un crime de tout cela maintenant, je ne te reproche pas l’isolement où tu m’as placé en brisant le cours de ces entretiens d’où nous retirions autant d’avantage que de plaisir. Je mets tout cela de côté: je souffre, je me tais, je me résigne doucement; non pas qu’il y ait rien de doux en tes injustes procédés, mais c’est qu’à partir du jour où se formèrent les noeuds de notre amitié, je me suis imposé la loi, si tu venais à me causer volontairement de la peine, de ne jamais te mettre dans la nécessité de donner aucune explication quelconque. Le mal que tu nous as fait n’est pas peu de chose, tu le sais bien, et pour l’apprécier tu n’as qu’à te rappeler ce que les étrangers disaient de nous, et ce que nous en disions nous-mêmes; de grands avantages devaient résulter pour nous de notre concorde: notre mutuelle amitié serait pour l’un et pour l’autre une sauvegarde; et, de l’avis de tous, l’utilité en rejaillirait même sur beaucoup d’autres. Pour moi, je n’ai jamais prétendu que je pour-rais, en ce qui me concerne, être de quelque utilité à personne; mais je me disais que nous en retirerions du moins l’avantage assez grand déjà, d’être invincibles, si quelqu’un s’avisait de nous attaquer. (568)
Voici les observations que je te faisais continuellement : les temps sont difficiles, les tendeurs d’embûches nombreux, la vraie charité est morte; le fléau de l’envie a pris sa place; nous marchons au milieu des pièges , et nous nous promenons sur les crénaux de la ville. Des gens tout prêts à se réjouir de nos disgrâces, s’il nous en arrivait, vous en verriez surgir une multitude de tous côtés, mais pour nous plaindre il ne se trouvera personne, ou du moins un nombre si petit, qu’il sera trop facile à compter. Gardons-nous, en nous séparant, d’encourir la risée publique, ou quelque dommage encore plus grave. Un frère soutenu par son frère est comme une ville forte, une capitale munie de barres de fer. (Prov. XVIII, 19). Ah! ne dissous pas une union si utile, ne brise pas les barres de fer de notre forteresse.
Je ne me lassais pas de te répéter ces choses et bien d’autres encore. Certes je ne soupçonnais rien de tel, je te croyais au contraire dans les dispositions les plus saines à mon égard; malgré la bonne santé que je te supposais, je voulais te soigner encore par surcroît, et à mon insu il s’est trouvé que c’était un malade, la suite l’a fait voir, à qui j’appliquais mes remèdes. Par malheur je n’y ai rien gagné, et mon excessive précaution a été en pure perte. Tu as tout rejeté, tu n’as rien reçu dans ton esprit, et moi tu m’as lancé comme un navire sans lest sur une mer immense, sans avoir égard à la fureur des vagues, qu’il me faut maintenant soutenir seul. Quand la calomnie, la raillerie, quelqu’autre insulte ou la persécution viendront fondre sur moi, accidents trop fréquents dans la vie, à qui donc aurai-je recours? A qui ferai-je part de mes découragements? Qui voudra me prêter secours? Qui arrêtera les auteurs de mes peines et fera cesser leurs vexations? Qui est-ce qui me consolera et m’apprendra à souffrir les, mépris des autres hommes? Je ne vois personne depuis que tu m’as quitté, toi .qui es maintenant si loin du champ de bataille où je vais lutter, que tu ne pourras pas même entendre mes cris. Comprends-tu maintenant tout le mal que tu m’as fait? Reconnais-tu au moins, après m’avoir frappé, combien est mortelle la blessure que j’ai reçue? Mais n’en parlons plus. Le mal qui est fait ne peut pas se réparer : comment trouver une issue dans un défilé qui n’en a pas? Seulement que dirons-nous aux étrangers? Que répondrons-nous à leurs accusations?