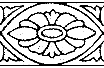28.
Un roi ne doit pas écraser ses sujets d’impôts; car pour un bon prince qu’est-il besoin de tant de richesses, quand il ne songe pas à élever, par ostentation, de somptueux édifices; quand il préfère la simplicité à l’étalage d’une ruineuse magnificence; quand il ne veut pas, jeune et avide de plaisirs, employer follement pour les jeux du théâtre le travail de beaucoup de bras? D’ailleurs, comme il n’a que rarement des ennemis à combattre, il n’est pas entraîné à ces dépenses que l’on ne peut calculer d’avance, quand il s’agit, comme disait un Lacédémonien, de nourrir la guerre.1 Un bon roi n’a pas à craindre, nous le disions tout à l’heure, qu’on lui tende des pièges, ni qu’on l’attaque. Il faut lever des impôts pour satisfaire à de réelles nécessités, mais rien au delà. Les collecteurs qui les recueillent cessent d’être odieux quand ils font remise au malheureux de l’arriéré qu’il ne peut solder, et quand ils mesurent aux ressources de chaque citoyen la contribution qu’il doit payer. Un roi qui a l’amour de l’argent est au-dessous d’un vil trafiquant: car celui-ci cherche à pourvoir aux besoins, de sa famille; mais pour le roi cupide il n’est point d’excuse. Pour moi, quand j’observe les effets des différentes passions sur les hommes, je crois voir que, même parmi les simples particuliers, ceux qui ne songent qu’à s’enrichir se font remarquer par la grossièreté de leurs habitudes et par la bassesse de leurs sentiments; et ce n’est que dans une société déjà corrompue qu’ils peuvent échapper au mépris. Eh! ne sont-ils pas les premiers à se ravaler quand ils intervertissent l’ordre établi par la nature? En effet elle a placé au premier rang l’âme, qui gouverne le corps; au second le corps, qui doit s’assujettir les choses du dehors: mais à ces choses, inférieures en dignité, ils subordonnent, eux, et l’âme et le corps. Quand ils se sont ainsi dégradés en faisant une esclave de la partie la plus élevée de leur être; serait-il encore possible d’attendre d’eux une action, une pensée grande et généreuse? Si je dis qu’ils méritent moins d’estime, qu’ils ont moins de sens que la fourmi, je n’exagère point; car la fourmi n’amasse que pour vivre, et eux ne vivent que pour amasser. Un souverain, qui veut être vertueux et régner sur des sujets vertueux, doit repousser loin de lui, loin de ses peuples, ce fléau de l’avarice; il doit exciter l’émulation de tous pour le bien, noble lutte où il est tout à la fois chef, combattant et juge. C’est une honte, dit un ancien, qu’il y ait des jeux publics où l’on dispute d’adresse à lancer le javelot ou de force dans les exercices du corps, et que des couronnes soient décernées aux vainqueurs, tandis qu’on n’a point institué de concours de sagesse et de vertu.2 Il est vraisemblable, plus que vraisemblable, il est certain que les hommes avaient un roi tel que je le dépeins, et le prenaient pour modèle, lorsqu’ils vivaient heureux, à cette époque reculée, appelée l’âge d’or, âge célébré par la poésie. Etrangers au mal, ils ne songeaient qu’à pratiquer le bien, et plaçaient en première ligne la piété, cette vertu dont le roi doit donner l’exemple en invoquant, avant de rien entreprendre, le secours divin. Eh! peut-on rien voir, rien ouïr de plus beau, qu’un roi s’associant à ses sujets pour lever les mains vers le ciel, et adorer le maître commun des princes et des peuples? Sans doute la Divinité se réjouit des pieux hommages que lui rend un souverain, et elle entretient avec lui une sorte de mystérieux commerce. Aimé de Dieu, le roi à son tour aime les hommes; il est pour ses sujets ce que le Roi du ciel est pour lui; et quelles faveurs n’a-t-il pas le droit d’attendre? J’en reviens au sujet que je traitais un peu plus haut.