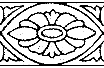CHAPITRE VIII. LUTTE INTÉRIEURE.
19. Alors, pendant cette violente rixe au logis intérieur, où je poursuivais mon âme dans le plus secret réduit de mon coeur, le visage troublé comme l’esprit, j’interpelle Alypius, je m’écrie : Eh quoi ! que faisons-nous là?, N’as-tu pas entendu? Les ignorants se lèvent; ils forcent le ciel, et nous, avec notre science, sans coeur, nous voilà vautrés dans la chair et dans le sang! Est-ce honte de les suivre? N’avons-nous pas honte de ne pas même les suivre? Telles furent mes paroles. Et mon agitation m’emporta brusquement loin de lui. Il se taisait, surpris, et me regardait. Car mon accent était étrange. Et mon front; mes joues, mes yeux, le teint de mon visage, le ton de ma voix, racontaient bien plus mon esprit que les paroles qui m’échappaient.
Notre demeure avait un petit jardin dont nous avions la jouissance, comme du reste de la maison; car le propriétaire, notre hôte n’y habitait pas. C’est là que m’avait jeté la tempête de mon coeur; là, personne ne pouvait interrompre ce sanglant débat que j’avais engagé contre moi-même ,dont vous saviez l’issue, et moi, non. Mais cette fureur m’enfantait à la raison, cette mort à la vie; sachant ce que j’étais de mal, j’ignorais ce qu’en un moment j’allais être de bien.
Je me retirai au jardin ; Alypius me suivait pas à pas. Car j’étais seul, même en sa présence. Et pouvait-il me quitter dans une telle crise? Nous nous assîmes, le plus loin possible de la maison. Et mon esprit frémissait, et les vagues de mon indignation se soulevaient contre moi, de ce que je ne passais pas encore à votre volonté, à votre alliance, ô mon Dieu, où toutes les puissances de mon âme me poussaient en me criant: Courage ! Et leurs louanges me soulevaient vers le Ciel: Et pour cela il ne fallait ni navire, ni char; il ne fallait pas même faire ce pas qui nous séparait de la maison. Car non-seulement aller, mais arriver à vous, n’était autre chose que vouloir, mais d’une volonté forte et pleine, et non d’une volonté languissante et boiteuse, se dressant à demi et se débattant contre l’autre moitié d’elle-même qui retombe.
20. Et dans cette angoisse de mes indécisions, je faisais plusieurs de ces mouvements de corps que souvent des hommes veulent et ne peuvent faire, soit absence des membres, ou qu’ils soient emprisonnés dans des liens, paralysés de langueur, retenus par quelque entrave. Si je m’arrache les cheveux, si je me frappe le front, si j’embrasse mes genoux de mes doigts entrelacés, je le fais parce que je l’ai voulu. Et je pouvais le vouloir sans le faire, si la mobilité de mes membres ne m’eût obéi. Combien donc ai-je fait de choses, où vouloir et pouvoir n’était pas tout un. Et alors je ne faisais pas ce que je désirais d’un désir incomparablement plus puissant, et il ne s’agissait que de vouloir pour pouvoir, c’est- à-dire de vouloir pour vouloir. Car ici la puissance n’était autre que la volonté; vouloir, c’était faire; et pourtant rien (435) ne se faisait; et mon corps obéissait plutôt à la volonté la plus imperceptible de l’âme qui d’un signe lui commandait un mouvement, que l’âme ne s’obéissait à elle-même pour accomplir dans la volonté seule sa plus forte volonté.