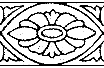6.
Une nuit, que j'étais éveillé, comme de coutume, je m'occupais en silence de ce qui me venait à l'esprit je ne sais d'où. Déjà le désir de trouver la vérité m'avait accoutumé à méditer ainsi ; et selon le mouvement de mes pensées, je passai sans sommeil la première ou la seconde partie, et presque toujours la moitié de la nuit. Je ne me laissais point-ravir à mmoi-même par les études de mes élèves; ils travaillaient pendant tout le jour seulement , et j'aurais condamné, comme un excès, qu'ils consacrassent encore les nuits à la poursuite de leur travail. Je leur avais aussi donné l'ordre de se créer une occupation en-dehors de leurs livres, et d'accoutumer leur esprit à demeurer en lui-même. Donc je veillais, ai-je dit, et voilà que le son de l'eau qui coulait près des bains captiva mon oreille, et je le remarquai plus attentivement que de coutume. Je trouvais tout à fait étrange que la même eau heurtant les mêmes cailloux, rendît un son tantôt plus doux et tantôt plus éclatant. Je commençai à m'en demander la cause, et rien, je l'avoue , ne se présentait. Mais Licentius frappant de son lit la boiserie voisine, effraya des souris qui l'importunaient; je sus ainsi qu'il était éveillé. Licentius, lui dis-je, as-tu remarqué, car je vois que ta muse t'a allumé un flambeau pour travailler1, le son inégal de cette eau ? Oui, dit-il, cela n'est point nouveau pour moi. Une nuit, en (n'éveillant, le désir du beau temps me faisait prêter l'oreille, j'écoutais si la pluie tombait, et cette eau murmurait comme à présent. Trygétius parla de même; lui aussi, couché sur son lit et dans la même pièce, veillait à notre insu, car nous étions dans les ténèbres, ce qui est presque nécessaire en Italie , même aux riches.
Ret, liv. I, ch. III, n. 2. ↩