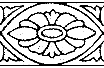CHAPITRE XX. LES LIVRES DES PLATONICIENS L’AVAIENT RENDU PLUS SAVANT, MAIS PLUS VAIN.
26. Les livres des Platoniciens que je lisais alors, m’ayant convié à la recherche de la vérité incorporelle, j’aperçus, par l’intelligence de vos ouvrages, vos perfections invisibles. Et là, contraint de m’arrêter, je sentis que les ténèbres de mon âme offusquaient ma contemplation; j’étais certain que vous êtes, et que vous êtes infini, sans cependant vous répandre par les espaces finis ou infinis; mais toujours vous-même, dans l’intégrité de votre substance, et la constance de vos mouvements; j’étais certain que tout être procède de vous, par cette seule raison fondamentale qu’il est; certain de tout cela, j’étais néanmoins trop faible pour jouir de vous.
Et je parlais comme ayant la science, et si je n’eusse cherché la voie dans le Christ Sauveur, cette science n’allait qu’à ma perte. Je voulais déjà passer pour sage, tout plein encore de mon supplice, et je ne pleurais pas, et je m’enflais de ma sagesse.
Car où était cette charité qui bâtit sur les fondations de l’humilité, sur Jésus-Christ lui-même? Et ces livres pouvaient-ils me l’enseigner? Et, sans doute, vous me les avez fait tomber entre les mains avant que j’eusse médité vos Ecritures, pour qu’il me souvînt en quels sentiments ils m’avaient laissé; et que dans la suite, pénétré de la douceur de vos saints livres, pansé de mes blessures par votre main, je susse quel discernement il faut faire de la présomption et de l’aveu; de qui voit où il faut aller, sans voir par où, et de qui sait le chemin conduisant non-seulement à la vue, mais à la possession de la patrie bienheureuse. Peut-être, formé d’abord par vos saintes Lettres, dont l’habitude familière m’eût fait goûter votre douce saveur, pour tomber ensuite dans la lecture de ces livres, j’eusse été détaché du solide fondement de la piété, ou bien même demeurant le coeur imbibé de sentiments salutaires, j’aurais pu croire que la lecture de ces philosophies suffit pour en produire de semblables.