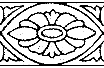CHAPITRE XV. LES PATRIARCHES ET LEURS CONCUBINES.
Dans la cité de notre Dieu, où, d'après l'union primitive de deux personnes humaines, le mariage a toujours été une sorte de sacrement, ce même mariage une fois conclu, ne peut se dissoudre que par la mort de l'un des deux époux. Le lien demeure dans toute sa force, lors même qu'une évidente stérilité empêcherait la réalisation du but pour lequel il a été formé. Dès lors, les époux qui savent d'une manière certaine qu'ils n'auront point d'enfants, ne peuvent se séparer pour cette raison et convoler à de nouvelles noces. Agir autrement, ce serait commettre l'adultère, car ils restent véritablement époux.
Chez les anciens, il était permis, du consentement de la première femme, d'en prendre une autre et les enfants qui en naissaient, étaient regardés comme des enfants communs, résultant des relations et du sang de l'un des deux époux, et du pouvoir donné par l'autre. Mais aujourd'hui ce serait un crime d'en agir ainsi; car le besoin de propagation qui existait alors, n'existe plus. Il était même permis, quoique la première femme fût féconde, d'en épouser d'autres, afin de multiplier la famille; ceci n'est plus permis. L'état des choses est aujourd'hui si différent qu'il est mieux de rester vierge, à moins qu'on n'ait besoin d'un remède à l'incontinence. Dans les premiers temps, ceux mêmes pour qui la continence était le plus facile, pouvaient, sans péché, épouser plusieurs femmes, à moins que des raisons de piété n'y missent obstacle. L'homme sage et juste, qui désire mourir et régner avec Jésus-Christ, et pour qui ce désir est le seul bonheur1, prend néanmoins de la nourriture, non pas par amour de la vie, mais par dévouement à son devoir et pour être utile à ses frères. De même les saints patriarches ne virent dans les relations avec leurs femmes qu'un devoir du mariage et non un moyen de flatter la volupté.
-
Philip. I, 23. ↩