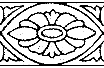II.
Ils immolent à Dieu de grasses victimes, comme s'il était pressé de la faim. Ils lui versent du vin, comme s'il était tourmenté de la soif. Ils allument des flambeaux devant lui, comme s'il était dans les ténèbres. S'ils avaient la moindre vue des biens célestes, dont la masse grossière et terrestre qui nous environne nous empêche de découvrir la grandeur, ils reconnaîtraient combien leur extravagance est extrême, quand ils s'imaginent pouvoir se rendre les dieux favorables par ces sortes de devoirs. S'ils regardaient le soleil avec quelque attention, ils jugeraient aisément que Dieu, qui a fait une si éclatante lumière pour l'usage de l'homme, n'a pas besoin de celle d'un cierge. Que si ce cercle qui, à cause de son grand éloignement, ne paraît pas beaucoup plus grand que la tête d'un homme, renferme un si vif éclat que nos yeux ne le sauraient supporter, quelle est la splendeur du jour qui environne ce Dieu qui n'a point de nuit? Il a tempéré la lumière et la chaleur du soleil, et les a mis au degré nécessaire pour mûrir les fruits et pour ne rien gâter des corps inférieurs. Peut-on croire qu'un homme, qui fait présent de cierges et de bougies à l'auteur et au dispensateur de la lumière, ait l'usage de la raison ? Il nous demande une lumière qui n'ait point de fumée, qui soit pure et claire, comme dit le poète : c'est la lumière de l'esprit, qui ne se trouve qu'en ceux qui connaissent Dieu. Les dieux des païens étant des dieux de la terre, ils ont besoin qu'on leur allume des cierges, afin qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Ceux qui les révèrent, n'ayant aucun goût pour les choses du ciel, leur rendent des devoirs qui ne s'élèvent jamais au-dessus de la terre. Sur la terre on a besoin de lumière, parce que, de sa nature, elle est sombre et ténébreuse. Les païens attribuent à leurs dieux un goût humain, au lieu de leur en attribuer un divin. Ils s'imaginent qu'ils aiment tout ce que nous aimons, et qu'ils ont les mêmes désire que nous, qui avons besoin de manger quand nous avons faim, de boire quand nous avons soif, de nous vêtir pour nous garantir du froid, et d'allumer des flambeaux pour nous éclairer quand le soleil nous a retiré sa lumière. Cette manière toute terrestre d'honorer les dieux est un des plus forts arguments par lesquels on prouve qu'ils ont autrefois vécu, et qu'ils sont morts ; car que peut-on s'imaginer de céleste dans le sang des victimes dont les païens infectent les autels? Se persuadent-ils que les dieux se repaissent de ce sang auquel les hommes auraient honte de loucher? Quiconque les en aura repus deviendra à l'heure même heureux, bien que ce soit un voleur, un adultère, un empoisonneur, un homicide. Il sera chéri et protégé des dieux, et il recevra de leurs mains libérales tout ce qu'il pourra souhaiter. Perse a eu grande raison de se railler de l'extravagance de ces superstitions, en demandant à ceux qui y étaient attachés:
A quel prix prétendez-vous acheter l'attention des dieux et leurs augures favorables ? et espérez-vous l'obtenir en leur présentant les entrailles d'une victime avec du lait et de l'huile.
Il voyait fort bien que, pour se rendre les dieux propices, il n'est point nécessaire de leur offrir la chair des animaux, mais une âme sainte et pure, un esprit juste et équitable, un cœur chaste et généreux. C'est là une religion toute céleste, qui consiste dans des vertus spirituelles, et qui n'a rien de la corruption de la terre. C'est là le culte sincère par lequel l'âme s'immole elle-même comme une victime. J'expliquerai, dans la suite de ce livre, de quelle sorte cette immolation doit être faite ; car il n'y a rien de si excellent ni de si conforme au devoir d'un homme que d'apprendre aux autres le moyen d'acquérir la vertu.
Catulus préfère, dans un dialogue de Cicéron, intitulé Hortensias, la philosophie à toutes choses, et témoigne qu'il aimerait mieux avoir composé le petit livre sur les devoirs de la vie civile, qu'une longue oraison pour un séditieux comme Cornélius. Je me persuade que c'était là le sentiment de Cicéron plutôt que de Catulus, qui n'a peut-être jamais rien dit d'approchant, et qu'il avait dessein de donner, comme par avance, une haute idée des livres des Offices qu'il méditait de composer, et dans lequel il a témoigné depuis que, dans toute l'étendue de la philosophie. Il n'y a rien de si utile que la morale et les préceptes qui règlent la vie. Si des hommes, à qui la vérité était cachée, ont entrepris d'instruire les autres, n'avons-nous pas plus de droit de l'entreprendre, nous qui avons été instruits et éclairés par Dieu même. Nous ne commencerons pas néanmoins par les premières leçons que l'on donne à ceux qui n'ont jamais entendu parler de la vertu; ce serait un travail infini. Nous supposerons les notions que les païens donnent à ceux qu'ils reçoivent dans leur école, et sur les fondements qu'ils ont posés nous élèverons l'édifice de la justice chrétienne à laquelle ils n'ont aucune part. Je passerai sous silence les règles qui leur peuvent être communes avec nous, de peur d'être accusé d'emprunter des preuves à ceux dont je réfute les erreurs.